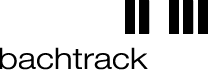Créé en octobre dernier par Esa-Pekka Salonen à la tête du San Francisco Symphony, le Concerto pour piano n° 3 de Magnus Lindberg, écrit spécialement pour Yuja Wang, retentit pour la première fois en France en ce jeudi soir sous les doigts de la pianiste, dans la grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris. Au travers d’un plan classique vif-lent-vif, les trois mouvements exploitent un thème musical à la Bartók, pianistiquement développé à la Rachmaninov et orchestré à la Ravel. Au gré d’épisodes savamment articulés – sans ruptures nettes, mais au contraire imbriqués les uns avec les autres –, le discours se construit autour d’une dramaturgie inéluctablement dirigée vers le grand crescendo final. Conclue par une coda cathartique, l’œuvre suit ainsi une trajectoire sur laquelle le fatum pèse de tout son poids.
Mais les idées ont beau se développer de façon organique et prendre place dans une forme évolutive constamment en marche, cette partition montre finalement plus de maîtrise que de véritable inspiration et le pastiche post-romantique finit par lasser. D’autant que si le Concerto est introduit, nourri, dirigé par le piano, et si la connivence est parfaite entre Yuja Wang et Klaus Mäkelä à la tête de l’Orchestre de Paris, la formation symphonique ne semble servir ici que d’ornement à la soliste. On regrette que l’écriture de Lindberg les fasse si peu interagir, si peu se rencontrer : le piano coule comme un fleuve au milieu des berges orchestrales, et les deux entités suivent leur chemin de façon trop parallèle. Dans ce monologue, la pianiste fait toutefois preuve d’une impériale autorité. La fermeté des avant-bras conjuguée à la souplesse des épaules apporte au jeu de la Chinoise du muscle, de l’intensité, mais jamais de raideur : au vu de la qualité de ses articulations, de l’aisance avec laquelle elle saute par-dessus les quatre-vingt-huit touches du Steinway, sa technique ne semble entravée par aucune limite physiologique. Pourtant, Lindberg ne s’est pas censuré quant à la virtuosité : incessante du début à la fin, celle-ci atteint des sommets lisztiens dans les cadences des deux premiers mouvements.
Introduite par le basson crépusculaire de Giorgio Mandolesi, la deuxième partie de soirée est consacrée à la Sixième Symphonie « Pathétique » de Tchaïkovski. Malgré la gestique spectaculaire de Mäkelä – qui semble fouiller les tréfonds de la partition – l’interprétation n’atteint les profondeurs du pathos que dans le premier mouvement quand, portant des cuivres gras et des cordes creusées à souhait, la direction se saisit avec vigueur de l’irrésistible élan de l’Allegro vivo. C’est la lourdeur qui domine malheureusement les trois mouvements suivants : alors que les manières excessives dans la valse à cinq temps – trop mondaine et sans la moindre mélancolie – étouffent tout le cantabile du deuxième mouvement, le troisième a l'âme d’une fanfare militaire certes fort rythmée, mais bien trop ciselée. L’Adagio lamentoso final ne parvient pas non plus à de hauts sommets de lyrisme, malgré un certain flux musical trouvé par le chef qui parvient finalement à faire s’élever quelques poignants contrechants. Loin de la sobriété professée par son mentor Jorma Panula, Klaus Mäkelä semble s’être laissé tenter par un trop-plein d’effets qui ne sert pas la dramaturgie de l’ouvrage.
Malgré l’attitude excessivement théâtrale et démonstrative du chef, on ne peut que constater l’excellence de la phalange parisienne sous sa direction : l’écoute est totale, l’équilibre est parfait, et chaque pupitre s’intègre parfaitement à la texture orchestrale. On s’interrogera en revanche sur la nécessité de donner au début du concert la Valse triste de Sibelius : pièce de rappel très rebattue, celle-ci continue de replonger les mélomanes parisiens dans le deuil de Philippe Aïche, ancien violon solo de l’orchestre dont la chaise reste toujours vacante.