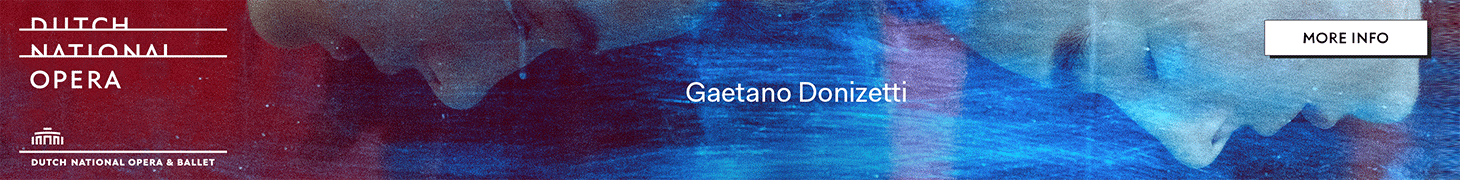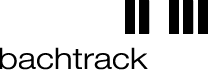Quand Sergueï Rachmaninov (1873-1943) quitte la Russie, il laisse derrière lui à peu près tout ce qu'il possède sur cette terre, ses amis et condisciples et n'emporte que ses souvenirs. « Lorsqu'à la Révolution j'ai dû quitter ma Russie bien aimée, je n'ai eu le droit d'emporter avec moi que cinq cents roubles pour chacun des quatre membres de la famille, et parmi toute la musique que j'avais je n'ai choisi qu'une partition : Le Coq d'or de Rimski-Korsakov » raconte le compositeur dans Réflexions et Souvenirs (Buchet/Chastel, 2019, 190 pages, 14 euros), recueil de textes et d'entretiens épars publiés de 1910 à 1943, réunis et traduits en français. Rachmaninov avait 44 ans, une solide réputation de compositeur et de chef d'orchestre, sans doute plus encore que de pianiste, bien qu'il fût déjà grandement admiré. Tout jeune il avait pu diriger à l'Opéra, y apprendre son métier et y présenter ses ouvrages lyriques de jeunesse sous le patronage de Tchaïkovski, et gagner quelques kopecks en enseignant.
Le musicien russe ne le savait pas encore mais il avait déjà composé la plus grande partie de son œuvre. Il n'écrira plus beaucoup à l'Ouest, ni aux Etats-Unis où il s'installera définitivement au lendemain de son dernier concert à Lucerne, sous la direction d'Ernest Ansermet, en août 1939. Mais Rachmaninov ne laissera que des chefs-d'œuvre de 1925 à sa disparition en 1943. La liste en est impressionnante : Symphonie n° 3, Danses symphoniques, Variations sur un thème de Paganini, Concerto pour piano n° 4, Variations sur un thème de Corelli, sans oublier la profonde refonte de son Concerto n° 1 et la révision de sa Sonate n° 2.
On ne trouvera pas dans cet ouvrage les raisons de ce relatif silence postérieur à son exil. On a dit qu'il était provoqué par le mal du pays, mais il pourrait bien avoir une tout autre explication : devant gagner sa vie rapidement, le quadragénaire a pu rapidement monter un répertoire de pianiste qu'il aurait mis des années à se constituer comme chef d'orchestre, et ainsi rapidement enchaîner récitals et concerts, en Europe et aux Etats-Unis, qui lui laisseront peu de répit. Ce petit livre l'évoque à peine, mais Rachmaninov soutenait énormément de gens et était un investisseur avisé, contrairement à son père qui avait ruiné la famille : il amassera une fortune colossale.
Il est beaucoup question de piano, de technique pianistique et d'art de l'interprétation dans ses Réflexions et Souvenirs. D'enseignement de la musique aussi, en plus des retours historiquement passionnants sur les années de jeunesse et de l'évocation d'Anton Rubinstein dont Rachmaninov nous dit qu'il était « le » pianiste par excellence et que sa technique était supérieure à celle de nombre de grands pianistes de la première moitié du XXe siècle. On trouvera des propos sur la question de l'interprète-compositeur, sur la nécessité de composer « avec son coeur » – ce qui pourrait paraître naïf si l'on oublie que Beethoven professait la même chose qui n'exclut en rien l'intellect –, sur la musique de son temps, sur l'Amérique. Quatorze chapitres qui se lisent en une après-midi mais vers lesquels on revient, car derrière la simplicité du propos se glisse souvent une réflexion qui hante la mémoire du lecteur et le pousse à reprendre ce livre. Celui-ci prend fin sur un doute : « Je ne sais pas si je réussirai à résoudre cet éternel conflit entre mes activités et ma conscience d'artiste. Je n'ai jamais pu décider quelle était ma véritable inclination : compositeur, pianiste ou chef d'orchestre. »
Quand Serge Rachmaninoff – c'est ainsi qu'il a toujours écrit son nom – confie cela, il n'est pas encore le compositeur admiré sans plus guère de réserves qu'il est devenu au XXIe siècle. Le paradoxe de ce créateur de la « génération » Debussy, Ravel, Sibelius, Prokofiev, Stravinsky, Strauss ou Bartók est que sa musique a été aimée spontanément du grand public, mais qu'elle a été pour une bonne part méprisée par nombre de chefs d'orchestres, de pianistes occidentaux et d'historiens de la musique. Ce n'est qu'à la fin du siècle dernier qu'elle a été réellement comprise, réévaluée et mise en lumière par une nouvelle génération d'interprètes. Nikolai Lugansky, Mikhail Pletnev, Kirill Petrenko, Daniil Trifonov rejoignent aujourd'hui les quelques grands des générations précédentes qui tenaient Rachmaninov en très haute estime.
Que serait-il advenu de Maria Youdina (1899-1970) si elle avait pu fuir l'Union soviétique, comme Rachmaninov et comme son cadet de quatre ans Vladimir Horowitz le fera en 1925 ? Aurait-elle triomphé, aurait-elle à peine rencontré le succès – comme Vladimir Sofronitzki à Paris –, serait-elle revenue au pays comme Serge Prokofiev, pour subir les avanies d'un pouvoir chaotique derrière les apparences d'une dictature effroyable incarnée par Staline ?
D'une certaine façon, Maria Youdina, la pianiste qui défia Staline (Jean-Noël Benoît, Les Editions de Paris Max Chaleil, 2018, 184 pages, 18 euros) répond en creux à cette interrogation. Juive convertie à la religion orthodoxe, amoureuse esseulée, mystique dans un pays totalitaire qui reconnaît officiellement la liberté de conscience pour mieux l'écraser quand elle se manifeste, Maria Youdina par son art et sa vie s'élevait au-dessus du pouvoir temporel des fonctionnaires zélés, comme des milieux musicaux plus snobs qu'on pourrait imaginer dans cette Russie-là.
L'auteur nous conte alors les dérives, les victoires, les drames, les éloignements que dut subir cette pianiste – Staline ne permettra cependant jamais qu'on touche à un seul de ses cheveux. Elle ne fut pas autorisée à franchir le rideau de fer. Pire : on lui laissa espérer un grand concert à Paris, qui fut même officiellement annoncé mais sera annulé au dernier instant par ses bourreaux de Gosconcert qui tentèrent même de lui voler sa mort. Dans le no man's land soviétique que l'on pourrait décrire par « ce qui n'est pas autorisé n'est pas interdit mais n'a pas lieu d'être », il a fallu d'abord le courage de la pianiste Vera Gornostaeva pour organiser en 1970 les funérailles de Youdina à Moscou, ensuite l'appui de Chostakovitch et le téléphone pour rameuter tout le monde devant le quasi silence de la presse officielle et enfin l'incroyable acte de Kirill Kondrachine et des musiciens de son orchestre : ceux-ci ont interrompu leur répétition pour venir dans le vestibule du Conservatoire Tchaïkovski jouer devant le cercueil de cette artiste inestimable, avec d'autres musiciens dont Sviatoslav Richter, Maria Grinberg et Gornostaeva. Des dizaines de télégrammes venus du monde entier saluèrent cette figure indomptable, dont ceux de Nono, Boulez, Pärt, Messiaen, Ligeti, Stravinsky, Jolivet...
Que serait devenue Youdina à l'Ouest, personne ne le sait. Mais en Union soviétique, elle fut admirée, adulée même pour son énergie, son indépendance d'esprit, sa culture encyclopédique et sa stature intellectuelle bien au-delà du cercle des musiciens. Ses disques sont là pour nous rappeler son art intransigeant et intimidant.
À côté de ces deux géants, Andrei Gavrilov (né en 1955) semble un enfant, mais son Tchaïkovski, Fira et moi : Scènes de la vie d'un artiste (Asteroid Publishing, 2017, 438 pages, 24 euros) ouvre en grand une fenêtre sur les terribles années que ce pianiste a vécues persécuté par le KGB, après la mort de Youdina, avant qu'il ne réussisse à quitter l'Union soviétique en 1984. Vainqueur du Concours Tchaïkovski, protégé par Sviatoslav Richter, chez lui dans Bach et Haendel comme dans la virtuosité la plus phénoménale, salué par le public et la presse du monde entier, ce pianiste a vu sa vie et sa carrière basculer sur la foi de rumeurs qui l'ont plongé rapidement dans le délire kafkaïen de la bureaucratie soviétique – il survivra même à quatre tentatives d'assassinat.
Son récit se lit comme le roman d'une vie d'artiste qui n'a pas bien fini, si l'on songe à ce qu'est devenue aujourd'hui la carrière de ce pianiste. Brossant des pages hallucinantes au milieu desquelles celles consacrées à son ami le pianiste Youri Egorov, ce livre est une évocation émouvante de moments de vie estudiantine qui ressemblent tant à celles que les enfants du baby boom ont pu vivre en Occident. L'admiration et l'affection que porte encore, quarante ans plus tard, Gavrilov à ce pianiste mort en pleine gloire en 1988 à l'âge de 34 ans sont un baume, au sein d'un ouvrage qui éclaire d'une lumière impitoyable la vie musicale et intellectuelle dans l'URSS des années qui précèdent de peu l'effondrement du pays.